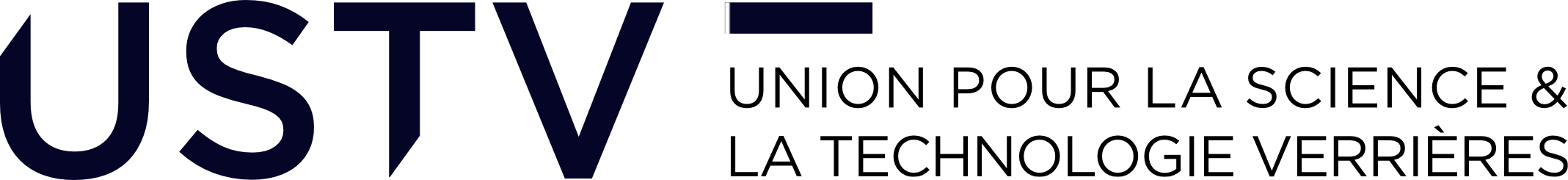Altération et couleur des glaçures bleues perses et mésopotamiennes
Type d’offre
Thèse
Localisation de l’offre
Paris, France
Date limite de candidature
31/05/2025
Date de prise de poste
Déposer votre candidature
Résumé
Description
L’utilisation de briques glaçurées polychromes a caractérisé l’architecture monumentale des palais et des villes du Proche Orient entre le XIVème et le IVème siècle avant l’ère commune (AEC). Au sein du département des Antiquités Orientales du musée du Louvre, sont conservées des briques provenant de Khorsabad (empire néo-assyrien, 721-705 AEC) et de Suse (royaume néo-élamite, 750-650 AEC, et empire perse achéménide, 522-486 AEC). Les glaçures bleues/turquoises/verdâtres sont principalement formées d’une matrice vitreuse silicatée sodo-calcique contenant des ions Cu2+. Dès leur production, ces glaçures pouvaient avoir une variété de couleurs liée aux environnements des ions Cu2+ dans le verre, à l’ajout éventuel d’opacifiants (cristaux d’antimoniates de Ca ou de Pb dispersés dans le verre) et à des paramètres de mise en forme comme l’épaisseur du verre et la nature du substrat (brique). Par la suite, ces couleurs peuvent évoluer du fait de l’altération chimique des glaçures (interaction du matériau verre avec l’eau de l’environnement). Très présentes dans les décors, ces glaçures bleues sont parmi les couleurs les plus affectées par le processus d’altération. Le constat de ces altérations soulève de nombreuses questions, et empêche la reconstitution de la polychromie originelle. Ce mauvais état de conservation pourrait être dû à la durabilité chimique diminuée de la matrice vitreuse par la présence des ions cuivre. Cette hypothèse fait partie de ce projet et est d’un grand intérêt dans le domaine de la chimie des verres. Ce projet sera structuré en deux axes de recherche.
Axe 1 : Caractérisation multi-échelle des glaçures historiques. Cette étape est nécessaire pour mieux comprendre le système complexe représenté par ces objets patrimoniaux, hétérogènes et à l’histoire partiellement méconnue. Une approche analytique intégrée sur des micro-prélèvements comprendra une caractérisation morphologique, colorimétrique, chimique élémentaire et structurale de ces glaçures, afin de déterminer la distribution et spéciation de l’élément cuivre au sein du verre et des phases d’altération, ainsi que la nature des phases cristallines (opacifiants, pigments…) dispersées dans la matrice vitreuse.
Axe 2 : Synthèse de verres modèles et tests d’altération. Cette étape en laboratoire a un double objectif : i) étudier l’effet des ions Cu2+ sur la durabilité des verres sodo-calciques et ii) étudier les chemins de dégradation de ces verres en lien avec l’évolution de leur couleur. Plusieurs verres seront préparés avec différents pourcentages d’oxyde de cuivre et différentes proportions relatives cuivre/opacifiants, et engagés dans des expériences d’altération modèles. Ces expériences mettront en œuvre des systèmes d’abord simplifiés (verre/eau) puis de plus en plus complexes (ajout d’acides et/ou de sels) et deux environnements différents représentant deux cas extrêmes du degré de confinement de l’eau en contact avec la surface du verre : en solution, et en conditions atmosphériques (85 % d’humidité relative).
Les techniques analytiques appliquées au cours de ce projet de thèse à la fois aux échantillons anciens et modèles feront appel à des instrumentations présentes au sein du laboratoire pour l’analyse des solutions (ICP-OES) et la caractérisation du solide (microscopie optique et électronique, résonance paramagnétique électronique RPE, spectroscopies IR et µ-Raman, ToF-SIMS), ainsi qu’à des techniques résolues spatialement par accès à des lignes de lumière synchrotron (µ-Fluorescence X, µ-Spectroscopie d’Absorption des Rayons X, µ-Diffraction des Rayons X). Les différents environnements du cuivre seront également reliés à leur spectre de réflectance optique afin de mesurer la couleur et d’en étudier l’origine chimique.
Cette recherche aidera les conservateurs et conservatrices du Louvre à identifier le nuancier des bleus/turquoises/verts effectivement maitrisé à ces époques et à reconstituer ces décors, dans le but de comprendre le déroulé historique des innovations techniques dans ces régions et de proposer une approche sensorielle de la connaissance historique. Ce travail permettra également d’identifier les facteurs de risque les plus importants (présence d’acides et/ou de sels dans l’environnement, valeurs d’humidité relative…) pour la préservation de ce patrimoine culturel.
Formation demandée
Expérience demandée
Nous recherchons un candidat avec une formation d’ingénieur ou M2 en chimie ou en sciences du patrimoine, avec une spécialisation en matériaux et/ou physico-chimie des surfaces, ayant un goût pour le travail expérimental, des qualités d’observation, et des qualités de rigueur et d’organisation du fait du grand nombre d’échantillons et de techniques d’analyse. Des notions d’archéologie et/ou de conservation du patrimoine seront appréciées.
Conditions